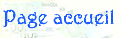
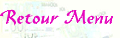


| Ilana RAMCHAR | Economie multiple / Secteur / Agriculture | Copyright de l'auteur |
|
Agriculture La majorité de la production des cultures GM (Génétiquement Modifiées) se situe dans une « poignée de pays où les secteurs agricoles sont fortement industrialisés et axés sur l’exportation », selon cette étude. En effet, les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, l’Argentine et le Paraguay concentrent à eux seuls 90% de cette production sur leurs terres. Les 4 principaux produits de ces cultures sont le soja, le maïs, le coton - qui, à eux trois, représentent 95% de la superficie plantée de GM au monde - et le colza qui représente les 5% restants. La plupart de ces produits agricoles servent à nourrir les animaux, à produire des biocarburants et à fabriquer des produits alimentaires élaborés, surtout consommés dans les pays riches. Pour exemple, l’Argentine exporte la plupart de son soja GM pour nourrir le bétail européen et les Etats-Unis réservent 20% de sa récolte de maïs à la production d’éthanol. Aucune des variétés commercialisées n’a été modifiée pour en augmenter le rendement, et les recherches se concentrent exclusivement sur celles qui tolèrent l’application d’un ou plusieurs herbicides.L'augmentation des surfaces cultivées : les terres arables représentent aujourd'hui 1,5 milliard d'hectares. Ce chiffre pourrait être presque doublé, selon l'étude prospective "World agriculture : towards 2030/2050" menée par la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). S'appuyant sur des images satellitaires, l'étude estime à 2,8 milliards d'hectares l'ensemble des terres utilisables, avec notamment des terres disponibles en Afrique et en Amérique du Sud. "Il est possible de multiplier par 1,7 la superficie cultivée tout en réservant les terrains nécessaires pour les habitations et les infrastructures et en préservant les forêts", estime M. Mazoyer. Cette thèse très optimiste est cependant contestée par d'autres experts. "Les terres apparemment vides sont déjà utilisées en jachères par rotation longue des cultures, souligne Michel Griffon, du Cirad (Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement). Je pense que les estimations de la FAO ne sont pas réalistes." L’arrivée des nouveaux européens amène dans ses bagages une aide européenne à l’agriculture pour ceux qui possèdent plus de 50 ha. Que faire alors de ceux qui vont disparaître parce que sans aide? La concentration du capital et des personnes dans les centres urbains va s’étendre un peu plus sur la planète. La PAC a accompagné la modernisation et la baisse du nombre d'exploitations, passé en France de plus de 3 millions dans les années 1950 à 600 000 aujourd'hui. Un de ses objectifs premiers était de moderniser l'agriculture et donc d'augmenter la surface des exploitations, en moyenne de 13 hectares à près de 45 en cinquante ans. Les départs à la retraite se sont cependant accélérés dans les années 1980 et 1990 avec l'apparition des quotas laitiers, le gel des terres, les aides directes, etc. La distribution des aides a favorisé la concentration dans les régions les plus productives. La PAC a cependant cherché à amoindrir les inégalités et à assurer l'occupation des territoires, avec des mesures comme les indemnités compensatrices de handicap naturel (pour les zones de montagne, par exemple) et les aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Très critiquée par les agriculteurs, la réforme de juin 2003 découple le montant des aides aux revenus dites aides directes du niveau de la production et les conditionne au respect de normes environnementales et sanitaires. Elle renforce aussi le "deuxième pilier" de la PAC, dont la vocation est de préserver le cadre rural. Les Etats membres se sont mis d'accord, lundi 20 juin, sur les modalités de ce soutien. En 2005, 50 milliards d'euros, soit 43 % du budget européen, sont consacrés à la PAC, alors que l'agriculture représente moins de 2 % du PIB européen. Ce chiffre considérable s'explique parce que la PAC est la seule politique entièrement fédéralisée. Son coût représente 1 % des impôts et cotisations sociales payées par les Européens. Si les Vingt-Cinq avaient décidé de faire de l'éducation une politique fédérale, celle-ci pèserait quinze fois plus que la PAC. Le budget de la PAC a été plafonné en 2002 et sa part est en déclin régulier. D'ici à 2013, elle ne devrait plus représenter qu'un tiers du budget européen, à parité avec les aides régionales, destinées aux pays les plus pauvres. Selon l'OCDE, les aides aux agriculteurs représentent 34 % de leurs revenus en Europe, 20 % aux Etats-Unis. La PAC a conduit à la surproduction tant que les mécanismes incitaient à produire pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Face aux montagnes de beurre, de lait en poudre, et aux stocks de viande bovine et de céréales, un changement a été amorcé en 1984 avec l'instauration des quotas laitiers puis, en 1992, avec la baisse des prix de soutien, qui ont été compensées par des aides directes au revenu des agriculteurs.A partir de 2006, en vertu de la réforme adoptée en 2003, les aides ne seront plus liées à la production des agriculteurs (principe du découplage). L'idée est que les exploitations peu productives cessent de produire inutilement et orientent leur production en fonction de la demande des marchés. A l'origine, la PAC n'a pas été conçue comme une aide à des individus, mais à quelques productions stratégiques, où l'Europe voulait atteindre l'autosuffisance alimentaire : céréales, lait et viande bovine. Les plus gros ont été volontairement favorisés. Cette répartition est contestée. En 2003, la Commission voulait plafonner à 300 000 euros l'aide maximale que pouvait toucher une exploitation. Cette disposition a été rejetée par les Allemands, soucieux de défendre les anciennes fermes collectives d'Allemagne de l'Est, et les Britanniques, qui entendent protéger les aides des grands propriétaires, en particulier de la reine d'Angleterre, qui touche 800 000 euros par an pour ses domaines de Windsor et de Sandringham. Les Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) ont commencé en 2001. Le principe repose sur l'achat par une soixantaine de consommateurs de la récolte d'un maraîcher au prix qui assure les coûts de production et une rémunération décente. Proposition : Mise en oeuvre : |
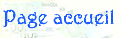 |
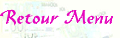 |
http://parolemultiple.free.fr |  |
 |