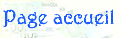
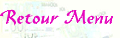


| Ilana RAMCHAR | Economie multiple / Aides à l'emploi | Copyright de l'auteur |
|
Les aides à l'emploi En 2005 en france, environ 40% des emplois sont des emplois aidés, qui ne sont pas directement payés par le marché productif ou de service.On doit pouvoir mettre en place une utilisation des emplois non marchands, au niveau local (ville ou agglomération) pour ceux qui ne trouvent pas de travail ou refusent les offres. Paiement au smic. exemples : nettoyages supplémentaires en journée - présence ou gardiennage - aide aux personnes dans le domaine public - aide aux activités associations. La PARE (Plan s'Aide au Retour à l'Emploi) permet la formation sur un besoin de main d'oeuvre répartorié par les entreprises et l'ASSEDIC qui prend en charge tous les frais de formation. Accord fédération bâtiment. Bonne réussite. MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DURABLE : L’embauche en CDI sera renforcée par un nouveau mode de calcul des cotisations sociales des entreprises. Les employeurs paieront moins de cotisations quand le contrat est à durée indéterminée et davantage quand il s’agit d’intérim ou de CDD. En outre, les cotisations sociales ne seront plus assises sur les seuls salaires mais sur l’ensemble de la richesse produite.
MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE RECLASSEMENT : Pour celles et ceux qui sont victimes de licenciements collectifs, le service public de l’emploi négociera avec le salarié un contrat lui permettant de suivre une formation, une qualification, pour un retour à l’emploi. C’est ainsi que sera assuré la sécurisation du parcours professionnel de chacun.
RÉTABLISSEMENT DES EMPLOIS JEUNES : dans le secteur public supprimés par le gouvernement Raffarin. De 1973 à 2002, les gouvernements successifs ont utilisé pas moins de 35 dispositifs différents. En 1999, 40 % des jeunes de moins de 26 ans ayant un emploi en bénéficiaient, contre 5 % en 1975, selon Yannick Fondeur et Claude Minni, respectivement chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES) et chercheur au ministère de l'emploi (Economie et statistique n° 378-379, 2004). Pourtant, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans, de 6 % en 1975, dépasse les 20 % trente ans plus tard (23 % pour les 15-24 ans), avec des périodes de baisse à la fin des années 1980 et des années 1990. Cela signifie-t-il que tous ces dispositifs ont échoué ?Emploi jeune (1997) En 1997, le gouvernement Jospin entend promouvoir le "développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes" selon les termes du projet de loi. Il va donc créer les emplois jeunes, qui permettent à des jeunes diplômés de décrocher un contrat de deux ans dans une filière "répondant à des besoins nouveaux ou non satisfaits ou favorisant le soutien à la vie associative, et présentant un caractère d'intérêt général". Ainsi de nombreux emplois sont créés dans les secteurs des nouvelles technologies et de leurs applications, de l'économie, du logement, des activités sportives, culturelles, éducatives, humanitaires et de coopération, d'environnement et de proximité. Contrat de qualification (1999) Le contrat de qualification est un mode de formation rémunéré en École/Entreprise ayant pour base la signature d ’un contrat de travail à durée déterminée (statut). Ce contrat, signé entre un jeune de 16 à 26 ans et l’entreprise d ’accueil a une durée de 6 à 24 mois selon la formation suivie. Il se différencie surtout de l ’apprentissage par ses objectifs et quelques critère plus mineurs. Les objectifs de la qualification ne sont pas seulement l ’acquisition d ’un diplôme. On parle avant tout d ’accès à une qualification reconnue par les professionnels (groupements ou branches professionnels, conventions collectives) et pas forcément par l ’État. Il est donc possible de signer un contrat de qualification pour passer un diplôme (Bac pro, BTS par exemple), ou pour se former à des spécialités professionnelles (secrétaire médical, vendeur spécialisé, assistant comptable entre autres). Il n ’est pas possible de cumuler deux contrats de qualification. En effet, il est prévu pour permettre l ’insertion professionnelle et non constituer un mode de formation tel que l ’apprentissage (voir ce dernier). C'est l'idée qu'il faut réduire le coût direct de l'emploi afin de réduire le coût de production. - Pour pouvoir vendre moins cher un bien qui ne semble donc pas essentiel. Cette idée implique que le même but serait atteint avec un pouvoir d'achat plus important des clients qui pourraient alors porter leur choix sur la qualité ou l'intérêt du bien plutôt que sur son prix bas. - Pour pourvoir au manque de travailleurs dans certaines branches ce qui montre que le travail est difficile ou que les salaires sont trop bas. Depuis la fin du deuxième millénaire, les entreprises réclament des politiques cette politique de l'aide à l'emploi afin de se dédouaner de la formation préalable et pour pouvoir facilement se débarrasser des travailleurs, ouvriers ou employés qui ne conviennent pas, à la fin de la période des aides. Proposition : Les aides contractuelles de réduction des charges doivent être liées à une embauche normale en CDD ou CDI après la fin du contrat aidé. Mise en oeuvre : Les demandes vont vers la constitution de bassins d'emploi, de maison de l'emploi, où il est possible pour les chômeurs, les collectivités locales, les centres de formation, d'approvisionner les besoins de plus en plus fluctuants des entreprises. A aucun moment le patronat n'envisage de coordonner ses embauches pour pérenniser les emplois créés . L'idée des emplois dans plusieurs entreprises est rejetée. Les zones franches ont été crées en 1995.
Elles sont limitées à certaines zones / quartiers
défavorisés. En dix ans il y a eu 60 000 emplois
crées sur 1,5 million d'habitant. C'est l'exonération de
charges fiscales. Chaque emploi qoûte environ 6000€ Proposition : Les aides à l'emploi doivent être liées à une formation afin d'embaucher ou pour redéployer un emploi. Angleterre - Mieux, avec 50%, le taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans est très supérieur à celui de la France ou de l’Allemagne. Cerise sur le gâteau: un système d’impôt négatif – ils reçoivent une allocation spéciale – permet aux salariés les plus modestes de gagner plus qu’en restant inactifs. C’est l’équivalent de notre «prime pour l’emploi», destinée à éviter les fameuses «trappes à pauvreté» qui dissuadent d’exercer un emploi mal payé de peur de perdre les prestations sociales et de payer l’impôt. Ceux qui doivent se contenter d’un temps partiel peuvent cumuler leur petit salaire avec une allocation logement ou une allocation familiale. Une famille de deux enfants dont l’un des parents travaille se voit ainsi garantir l’équivalent de 1 700 euros par mois (1 100 euros pour un parent isolé travaillant au moins seize heures par semaine). C’est assez pour vivre – pas très bien –, et cela n’incite pas à s’installer dans un statut d’assisté. Les sceptiques et les détracteurs du système s’interrogent sur le sort des 2,8 millions d’«handicapés», exclus de la comptabilité chômeurs même si un bon tiers d’entre eux seraient, dit-on, prêts à travailler. Mais, au total, cette stratégie qui tourne le dos à la réduction du temps de travail est gagnante. Grâce à cette mobilisation massive, la population active britannique (15 à 64 ans) est supérieure à la population active française (75% contre 62%). Du coup, en dépit d’une productivité horaire de 25% plus faible, le pays produit logiquement davantage. Et s’enrichit plus vite. Parce que le nouveau travailleur renonce à la fois à l'allocation qui lui permettait de vivre (RMI, ASS…), mais aussi aux aides qui y étaient liées. Dans un récent rapport sur les minima sociaux, la sénatrice UDF Valérie Létard en détaille la liste: par exemple, le titulaire du RMI perd l'allocation logement à taux plein, l'exonération de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle, la prime de Noël, etc. Et encore, toutes les prestations - notamment celles versées par les collectivités locales - ne sont pas prises en compte. La parlementaire signale les efforts pour améliorer la situation mais, écrit-elle, la «désincitation» financière subsiste pour les personnes reprenant un travail à temps partiel. Ce qui explique que la France compte environ 1 million de travailleurs pauvres: leur revenu est inférieur à 60% du revenu médian (qui est d'environ 1 200 euros). Le RSA est destiné
à corriger cette
situation: un complément financier - calculé de
manière à éviter les
effets de seuil - serait versé jusqu'à ce que les revenus
atteignent
1,4 fois le Smic pour une personne seule et 2 Smic pour un couple. Le
coût serait de 6 à 8 milliards d'euros. Cette
mécanique ressemble
beaucoup à l'allocation compensatrice de revenu, proposée
par
l'économiste Roger Godino. Elle s'apparente à
l'idée du crédit d'impôt,
utilisée par les pays anglo-saxons et qui a reçu, en
France, une
application avec la prime pour l'emploi. Mais elle diffère de
l'allocation universelle défendue, notamment, par Christine
Boutin,
député: tout citoyen recevrait cette prestation, libre
à lui de la
compléter en prenant un emploi. Dans ce cas, il n'est nullement
question d'encourager le travail. On reconnaît un droit à
chacun. Reste
à le financer…
Le RSA, lui, coûterait moins cher et surtout, sa philosophie est différente: son but est de donner une place centrale au travail en le rémunérant davantage. Mais il peut se lire comme un renoncement: notre société serait incapable de fournir un travail correctement payé à tous. Ou comme un aveu: l'assistance découragerait l'activité. |
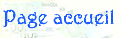 |
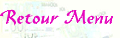 |
http://parolemultiple.free.fr |  |
 |