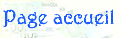
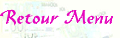


| Ilana RAMCHAR | Economie multiple / Les impôts / Quel partage ? | copyright de l'auteur |
|
Quel
partage ? Le partage de la Valeur Ajoutée (VA) est, en effet, au cœur des relations économiques et des tensions sociales d'un pays, puisqu'il s'agit d'identifier comment la richesse produite par une société est répartie, in fine, entre trois grands bénéficiaires : les ménages, qui perçoivent les revenus du travail (salaires), l'Etat, qui réalise des prélèvements obligatoires (impôts, cotisations sociales), et les actionnaires, dont on rétribue le capital. D'Adam Smith à Keynes, en passant par Marx, nombre de penseurs se sont penchés sur le sujet, mais aucune théorie, jusqu'à maintenant, n'a réussi à définir ce que pourrait être "le" partage optimal de la VA. Pour Philippe Askenazy, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au Centre d'études prospectives d'économie mathématique appliquée à la planification (Cepremap), toute analyse sur l'évolution du partage de la valeur ajoutée d'une année sur l'autre est largement sujette à discussion. Quels que soient les pays du monde auxquels on s'intéresse, on trouve, si l'on s'intéresse aux grandes masses bien sûr, un rapport deux tiers pour les salaires/un tiers pour la rémunération du capital. C'est le cas au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, etc." A regarder de près l'évolution du partage de la VA au sein de l'Hexagone, on peut définir quatre périodes. La première - les années 1960 et le début des années 1970 - montre une certaine stabilité du rapport entre salaires et profits (62 %/38 %) : la France est en pleine croissance, le chômage est faible, les salaires augmentent, mais les gains de productivité réalisés permettent de maintenir les bénéfices des entreprises. En 1973, le choc pétrolier (+ 25 % de hausse des prix de l'énergie entre l'été 1973 et l'été 1974) casse cet équilibre. Les salaires indexés sur le taux d'inflation progressent, le rapport passe à 67 %/33 % environ, et ce jusqu'en 1983, qui inaugure la troisième période, celle d'une chute féroce de la part de la VA dédiée aux salaires : "Les économistes l'expliquent surtout, reprend Philippe Askenazy, par la désindexation des salaires sur les prix et la politique de rigueur menée par Jacques Delors - alors ministre de l'économie - pour rétablir la compétitivité française. Dernière période enfin, celle qui s'ouvre au début de la décennie 1990, où l'on revient à une stabilité entre salaires et profits, comme dans les années 1960, mais à un niveau plus favorable (entre deux ou trois points de mieux) pour les profits. Le fort taux de chômage, qui ne met pas les organisations syndicales en position de force pour négocier une hausse des rémunérations, ajoutée à la pression des actionnaires sur les dirigeants d'entreprise pour améliorer la profitabilité, ne permet pas aux salariés de regrignoter le terrain perdu. Marie-Béatrice Baudet • ARTICLE PARU DANS L'EDITION du
monde DU 25.01.05
Proposition : Mise en oeuvre : |
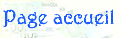 |
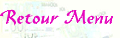 |
http://parolemultiple.free.fr |  |
 |