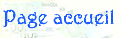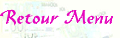Vue
globale des impôts
3,6 milliards d'euros récoltés en
2006
Les
principales explications à ce phénomène
résident dans l’augmentation
des prix de l’immobilier et de la bonne santé de la Bourse. Du
coup,
près de 3,6 milliards d’euros ont été
récoltés au titre de l’ISF en
2006, soit 20% de plus que l’année précédente. Et
selon le Syndicat
national unifié des impôts, le nombre de contribuables
concernés
devrait augmenter de 32 000 en 2007.
Afin de limiter l'impact de cet impôt, le gouvernement Villepin a instauré un "bouclier fiscal" plafonnant à 60% des revenus d'un contribuable le montant de ses impôts directs. La mesure, entrée en vigueur en janvier 2007, n'a pour l'instant guère eu de succès, avait indiqué Le Figaro dans son édition du 9 mai. Alors que le gouvernement tablait sur un total de 93 000 bénéficiaires, seules 1 400 demandes avaient été déposées fin avril, dont 300 auraient été rejetées. Le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, a promis d'abaisser à 50% des revenus le "bouclier fiscal" et d'y inclure les prélèvements sociaux, dont la CSG. Pas sûr que cela soit suffisant pour faire revenir les exilés fiscaux. 649 grosses fortunes avaient décidé de quitter l'Hexagone en 2005, deux fois plus qu'en 2003..
Le poids des dépenses publiques dans le PIB des pays développés sont passées (selon l'OCDE) de 26% en 1965 à 37% en 2001. Et là où la croissance des dépenses publiques est la plus forte, la croissance est aussi la plus forte.
Les politiques qui s'adressent à au moins une majorité (il y a plus de pauvres que de riches) ont donc tendance à pousser dans le sens de la redistribution ce qui contre un peu la volonté d'accaparement du capital.
La tendance côté capital est donc de rendre mercantile le plus de marchés possibles (celui des aides aux pauvres est un très grand marché) pour récupérer une partie des aides de la redistribution faite par l'état.
Le premier donne, la seconde reprend: d'un côté, l'impôt sur le revenu diminue; de l'autre, les prélèvements sociaux augmentent. Et voilà pourquoi les Français ne croient guère aux promesses fiscales
| Les 10
principaux
impôts payés par les ménages
(milliards d'euros) |
||
| 2003 | ||
| TVA |
109,7 | |
| CSG |
64,4 | |
| IRPP |
53,3 | |
| Taxe
foncière |
16,6 |
|
| TIPPétroliers |
12,1 |
|
| Taxe d'habitation |
10,1 |
|
| Droits tabac |
8,8 |
|
| Droits successions |
6,3 |
|
| ISFortune |
2,3 |
|
| Droits donations |
0,8 |
|
Si la baisse de l'impôt est
sujette à
controverse, c'est, notamment, parce qu'elle est difficile à
mesurer.
On a le choix entre deux méthodes. D'abord, le fameux taux de
prélèvements obligatoires, devenu enjeu du débat
politique, surtout
pertinent sur le long terme (voir le tableau). Ensuite, le calcul, en
milliards d'euros, des économies réalisées par les
contribuables après
une décision politique de baisse ou d'exonération.
«Economiser» ne
signifie pas forcément «payer moins». Exemple: les
taux du barème de
l'impôt sur le revenu (IR) ont baissé en moyenne de 9%
depuis 2002,
mais, globalement, les Français acquittent plus d'IR puisque la
masse
de leurs revenus a - heureusement - progressé.
Que l'on regarde un quart de
siècle en
arrière ou que l'on dresse le bilan fiscal de Jacques Chirac
à
mi-quinquennat, le constat est à peu près le même:
réduction relative
de la ponction de l'Etat, hausse des prélèvement sociaux.
«En deux ans
et demi, les impôts n'ont pas baissé. En gros, ce que vous
ne payez
plus en termes d'impôt sur le revenu, vous l'acquittez en CSG
supplémentaire», souligne Philippe Marini, sénateur
UMP de l'Oise. «Il
n'y a pas de baisse, à l'exception de celle de l'impôt sur
le revenu;
en revanche, les droits indirects et la CSG augmentent»,
renchérit
Didier Migaud, député socialiste de l'Isère. Que
ce diagnostic soit
partagé - même si Marini approuve la diminution de l'IR
quand Migaud la
déplore - explique l'incrédulité des
Français. Voici en quoi elle est
fondée.
1. Oui, l'Etat a baissé ses impôts
Ce recul concerne,
essentiellement, l'impôt sur le revenu. Il a pris
deux formes. D'abord, la réduction des taux du barème.
Ainsi, le plus
élevé est passé de 53,25 (en 2001) à 48,09%
(en 2004) et le plus bas de
8,25 à 6,83%. Au total, une économie de 5 milliards
d'euros pour les
contribuables. Ensuite, des incitations ciblées en faveur du
crédit à
la consommation, des emplois à domicile, etc. Soit un gain de
900
millions d'euros. En fait, le gouvernement Raffarin a continué
le
travail entamé par Edouard Balladur en 1993, prolongé par
Alain Juppé
en 1996 et repris avec éclat par la gauche: Laurent Fabius,
ministre de
l'Economie, a réduit l'impôt sur le revenu de 7,3
milliards d'euros.
Cette démarche semble toutefois abandonnée au sein du PS…
«Nous avons
diminué l'IR, mais aussi d'autres impôts, comme la TVA.
Aujourd'hui,
nous ne nous engageons pas sur des baisses d'impôts»,
affirme Didier
Migaud.
|
Par ailleurs, le gouvernement
Raffarin
a augmenté de 410 millions d'euros la prime pour l'emploi (PPE),
créée
par son prédécesseur pour les salariés modestes.
Elle vient en
déduction de leur impôt sur le revenu, de leur CSG et de
leur CRDS
(contribution au remboursement de la dette sociale) ou leur est
versée
sous forme de prestation.
Enfin, le patrimoine bénéficie d'un allégement
substantiel, avec
notamment la mesure Sarkozy sur les successions (exonération de
droits
jusqu'à 100 000 € de patrimoine).
2. Mais la Sécurité sociale ponctionne davantage
Entre 1980 et 2003, le poids de
ses prélèvements et de ceux des autres
organismes sociaux s'est alourdi de plus de 3 points, passant de 18,4
à
21,8% du PIB. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin prolonge la
tendance. Certes, ces hausses s'inscrivent dans des réformes
d'ensemble
(retraites en 2003, assurance-maladie en 2004). Mais les bienfaits de
celles-ci sont à venir, les conséquences négatives
de celles-là sont
déjà tangibles. La hausse de la CSG représente
à elle seule 2,2
milliards d'euros, répartis sur plusieurs types de
contribuables:
salariés, retraités imposables, épargnants et
adeptes des jeux.
Par ailleurs, les fonctionnaires
vont
acquitter 1 milliard d'euros au titre d'une nouvelle cotisation pour
leur retraite complémentaire. Au moins auront-ils un jour la
satisfaction de recevoir quelque chose en retour. En revanche, les
abonnés au gaz et à l'électricité
trouveront saumâtre, au nom de la
même réforme, cette «contribution tarifaire»
qui va bientôt apparaître
sur leur facture: un prélèvement obligatoire de plus!
«Mais pas de
hausse pour le consommateur, car cette somme figure déjà
dans le prix
payé, elle est simplement “extériorisée”, affirme
Bernard Brun,
président de l'Union française de
l'électricité. Elle représentera
entre 1 et 2% de la facture.» Raisonnement exclusivement valable
pour
2005: au-delà, rien n'est garanti.
|
Alors, la gestion du social
serait
laxiste et celle de l'Etat vertueuse? C'est oublier que les
décisions
relèvent souvent des mêmes responsables: le gouvernement,
qui accorde
d'un côté la baisse de l'IR et impose de l'autre la hausse
de la CSG.
Et les liens financiers entre l'Etat et la Sécu sont nombreux et
complexes. Seuls les régimes sociaux gérés de
manière paritaire par le
patronat et les syndicats, comme l'Unedic et l'Arrco-Agirc,
bénéficient
d'une certaine autonomie. Elle est toute relative quand, par exemple,
Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale,
décide de
réintégrer les «recalculés» parmi les
allocataires de l'Unedic. De
toute façon, les mêmes causes produisant les mêmes
effets (hausse du
chômage, vieillissement de la population), les cotisations
décidées par
les partenaires sociaux ont aussi augmenté. Par exemple, celles
versées
à l'Unedic ont été relevées à deux
reprises en 2002 et 2003, passant de
2 à 2,4% (part du salarié).
3. Alors, qui gagne et qui perd?
Notre tableau montre que,
globalement, pour les ménages, hausses et
baisses s'équilibrent. Mais chaque contribuable est un cas
d'espèce. A
priori, les redevables de l'IR (15,7 millions de foyers fiscaux) sont
gagnants. Parmi eux, les plus hauts revenus sont les mieux lotis. C'est
la logique d'un impôt progressif. «Je regrette que le
gouvernement et
sa majorité n'assument pas davantage ce choix, estime Philippe
Marini,
quand on veut encourager la créativité et le dynamisme,
on ne peut pas
dépasser un certain niveau de taux de taxation sur les
personnes.»
Selon les calculs du Syndicat national unifié des impôts
(Snui), un
foyer déclarant 100 000 € en a économisé
3 361 grâce aux baisses
intervenues depuis 2002. Et ce gain est 17 fois supérieur
à la CSG
supplémentaire (environ 190 € de plus par an) qu'il
acquitte sur son
salaire depuis le 1er janvier. Mais ses revenus financiers supportent
une ponction sociale supplémentaire de 1 point (0,7 pour la CSG
et 0,3
pour la loi sur la dépendance). A l'autre bout de
l'échelle, celui qui
perçoit 12 000 € par an et bénéficie de
la PPE est aussi gagnant: il
aura économisé 510 € grâce à la
montée en charge de cette prime, depuis
2002 (calculs du Snui), une somme 22 fois supérieure à la
ponction
supplémentaire de CSG (23 € par an). Mais lui aussi paiera
plus de CSG
sur son patrimoine, sauf s'il se résume à un livret A (et
produits
assimilés).
En revanche, ceux qui n'acquittent pas l'IR et ne touchent pas la PPE -
11 millions de foyers - subissent les hausses sans compensation.
Même
si chacune d'elles reste modeste, leur accumulation donne un sentiment
d'accablement: cotisation Unedic, essence, revenus de l'épargne,
etc.
Sans compter les ponctions dues à la fiscalité locale,
très variables
selon la géographie. Finalement, une seule augmentation peut
être
évitée: celle du tabac. Il suffit… d'arrêter de
fumer! Entre 2002 et
2004, le prix du paquet de 20 cigarettes est passé de 3,60
à 5 €.
Jusqu'en 2003, une hausse de 1 € générait 80
centimes de recettes
supplémentaires. Depuis janvier 2004, une augmentation ne
rapporte plus
rien du tout: les prix ont atteint un tel niveau que les consommateurs
renoncent au tabac (c'était le but recherché) ou
recourent à la
contrebande (ce qui l'était moins).
|
|
4. A qui profite la baisse des charges sociales?
Elles ont reculé de 5
milliards d'euros depuis 2002. En termes
comptables, cette somme a bénéficié aux
entreprises qui ont réduit
d'autant leurs versements à l'Urssaf. Le gouvernement affirme
que cet
argent profite, en réalité, aux ménages: parce que
ces baisses de
charges ont été calibrées de manière
à compenser la hausse du salaire
minimum décidée dans le cadre de l'harmonisation des
différents Smic
issus de la loi sur les 35 heures. Ces 5 milliards ayant permis une
progression du pouvoir d'achat, ils s'analysent, en termes
économiques,
comme un avantage pour les salariés concernés et non pour
leurs
employeurs.
L'argument est juste, mais ce
gain sur
les fiches de paie, s'il est financé sur fonds publics, ne doit
rien à
une réduction d'impôts. Et quand le relèvement
volontariste du Smic
aura été absorbé par les entreprises (le dernier
volet, 5,5%, est prévu
pour le 1er juillet 2005), la baisse des charges continuera de
s'appliquer. Elle devrait même être amplifiée,
puisque Jacques Chirac a
demandé - vœux aux forces vives, le 4 janvier - que toutes les
cotisations patronales qui frappent le Smic disparaissent d'ici
à trois
ans. Pour éviter une «trappe à bas salaires»
- les employeurs
maintiendraient leurs salariés au Smic - les
rémunérations un peu
supérieures à ce minimum seraient aussi concernées.
5. La baisse de l'impôt sur le revenu peut-elle se poursuivre?
Jacques Chirac a annoncé
sa reprise (après une interruption dans le
budget 2005). Hervé Gaymard, ministre de l'Economie, l'a
chiffrée
(Europe 1, le 9 janvier), estimant que le respect de la promesse
présidentielle - réduction de 30% entre 2002 et 2007 -
était
«réalisable». Il reste 21% à effectuer, ce
qui suppose d'y consacrer 10
milliards d'euros étalés sur deux années, 2006 et
2007, soit 5
milliards d'euros par an. Or l'addition pour 2006 est
déjà très lourde:
de 1 à 6 milliards d'euros pour faire disparaître les
charges sociales
au niveau du Smic et autour; 4,3 milliards pour honorer des mesures
déjà votées (budget 2004, 2005, etc.); 2 milliards
d'euros
supplémentaires si nos partenaires européens acceptent la
baisse de la
TVA (de 19,6 à 5,5%) dans la restauration (on le saura au cours
du
second semestre 2005). Voilà une grosse douzaine de milliards
d'euros à
trouver pour la seule année 2006. Avec une autre contrainte:
dénicher
7,7 milliards d'euros pour remplacer la soulte versée par EDF,
une
recette exceptionnelle qui a permis de réduire les
déficits publics
pour 2005. Un exploit herculéen si, comme l'a promis
Jean-François Copé
(Le Grand Rendez-vous d'Europe 1, le 30 janvier), «la baisse des
impôts, c'est une dépense comme une autre, elle sera
gagée sur des
économies». Ce que conseille d'ailleurs vivement Nicolas
Sarkozy,
président de l'UMP. Aussi Copé se refuse-t-il à
annoncer tout objectif
chiffré. Si baisse il y a en 2006, elle risque donc d'être
symbolique,
de l'ordre de 1%, soit 500 millions de mieux pour les contribuables.
6. La hausse des prélèvements sociaux va-t-elle continuer?
Oui. Une hausse des cotisations
d'assurance-vieillesse inscrite dans la
réforme des retraites est déjà prévue pour
2006: 0,2% de plus, soit 750
millions d'euros (dont la moitié à la charge des
salariés). Le plus
lourd est à venir: la loi Fillon du 21 août 2003 ne
finance que le
tiers des 15 milliards prévisibles de déficit du
régime de retraite des
salariés. Les 10 milliards manquants proviendront d'une nouvelle
hausse
des cotisations. Selon un scénario vertueux, elle serait
compensée par
une baisse équivalente des prélèvements Unedic,
grâce au recul du
chômage. Cet espoir - fondé sur le raisonnement
démographique - n'a
plus que trois ans pour se concrétiser: c'est en 2008 qu'il
faudra, au
vu de prévisions économiques révisées,
prendre une décision sur les 10
milliards.
Enfin, la réforme de l'assurance-maladie comporte, outre la
hausse de
la CSG, un maintien de la CRDS au-delà de 2014 (sa date
d'extinction
prévue) et pour une durée non déterminée.
Ce prélèvement «provisoire»
créé par Alain Juppé en 1996 et déjà
prolongé par son successeur à
Matignon, Lionel Jospin, semble avoir la vie longue. Les Anglais n'ont
pas tout à fait tort quand ils disent que rien ne dure
éternellement
sauf la mort et les impôts!
l'express 9-2-2005
proposition :
mise en oeuvre :