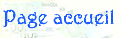
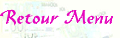


| lana RAMCHAR | Economie
multiple / Actionnariat / Concentration |
Copyright de l'auteur |
|
Concentration
du capital En 2004, les
sociétés
européennes ont davantage
reversé d'argent à leurs actionnaires qu'elles n'ont
levé de capitaux.
C'est un paradoxe puisque la raison d'être des marchés est
d'irriguer
l'économie. L'épargne est abondante. Mais celle-ci
comble surtout
les déficits publics. Pour Patrick Artus, chef économiste d'Ixis CIB, le fait que "l'épargne n'aille plus vers le système productif" constitue un changement majeur, lourd de conséquences pour l'économie. "Nous ne sommes plus dans le cercle traditionnel : les profits d'aujourd'hui financent les investissements de demain. Les marchés n'assurent plus le financement de la croissance, mais uniquement celui des déficits des Etats", s'inquiète-t-il, persuadé que ces mécanismes ne peuvent que conduire à un développement de plus en lent de l'économie, les profits redistribués aux actionnaires ne servant pas, selon lui, à soutenir la consommation. D'autant que près de la moitié de ces revenus du capital vont à des investisseurs étrangers. D'autres pensent que les changements sont plus structurels. "Nous sommes revenus à la situation d'avant 1914, à un capitalisme de rente dans lequel les revenus de patrimoine et la rente obligataire priment sur les revenus du travail et les actions", dit M. Petit. Si cette hypothèse se confirmait, les marchés seraient alors contraints de se poser la question de leur rôle. Avec 85 milliards de dollars de bénéfices nets cumulés pour les cinq majors mondiales, l'industrie pétrolière dispose d'une force de frappe sans précédent. Une puissance financière sous-utilisée, faute de gisements où investir. Une nouvelle phase de concentration s'annonce. Près de 85 milliards de dollars, soit près de 65 milliards d'euros. C'est le montant total des profits engrangés par les cinq premiers groupes pétroliers privés mondiaux en 2004. Après ExxonMobil (25,33 milliards de dollars), Shell (18,5 milliards), BP (16,2 milliards) et ChevronTexaco (13,3 milliards), Total a rejoint le club des groupes qui dégagent des profits à deux chiffres (en milliards de dollars) : 11,2 milliards en 2004 (9 milliards d'euros)."Des profits obscènes, alors que le prix de l'essence à la pompe, du gaz et de l'électricité domestiques ne fait qu'augmenter", s'est indigné Tony Woodley, le chef du syndicat britannique T & G, qui propose d'instaurer une taxe exceptionnelle (windfall tax) sur les bénéfices excessifs des géants des hydrocarbures, avec le soutien de nombreux députés travaillistes. Une proposition vite écartée par le gouvernement Blair, à quelques semaines d'élections législatives outre-Manche. La décorrélation des profits et des investissements n'est certes pas nouvelle. "Le poids des capitaux investis dans la seule activité d'exploration continue de décroître et ce depuis déjà une dizaine d'années", relevait récemment une étude de l'Institut français du pétrole. Les compagnies pétrolières privées ont pourtant toutes annoncé de fortes hausses de leurs investissements pour cette année. Shell compte passer d'un rythme annuel de 13,4 milliards de dollars en 2004 à 15 milliards en 2005 et 2006. Total va porter les siens à 12 milliards en 2005 (contre 9 milliards de dollars en 2003). Depuis plusieurs années, les compagnies extraient davantage de pétrole et de gaz qu'elles n'en découvrent. Or, selon le consultant Sanford Bernstein, pour accroître sa production de 3 % l'an, une compagnie devrait atteindre 137 % de taux de renouvellement annuel de ses réserves. On est loin du compte. Entre 4000 et 5000 PME en forte croissance devraient accéder cette année au statut de "gazelle", qui leur offre notamment des avantages fiscaux. Et le gouvernement crée un fonds de 2 milliards d'euros pour aider au capital-risque. Le gouvernement ne veut pas faire des PME une espèce en voie de disparition. Il a donc choisi de soutenir les « gazelles », le nom qu'il a donné aux entreprises en forte croissance. Environ 2000 d'entre elles avaient reçu ce label en 2005, sur des critères liés au chiffre d'affaires. Cette année, elles devraient être entre 4000 et 5000 à pouvoir bénéficier de ce statut préférentiel, qui leur permet de ne pas payer d'impôt sur les sociétés durant le temps de leur développement et de faire reporter toute augmentation des charges sociales.Proposition : Les aides aux entreprises ne peuvent être faites que sur présentation des factures et les avances faites doivent être remboursé&es au fur et à mesure des bénéfices enregistrés Mise en oeuvre : |
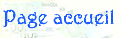 |
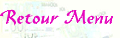 |
http://parolemultiple.free.fr |  |
 |