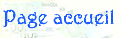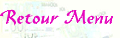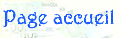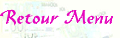|
Histoire
concentration du capital
Avec la concentration du capital entre des mains de
propriétaires de
moins en moins nombreux la boucle de la démocratie se referme
lentement.
Cyrus l'achéménide de Perse est le premier vrai
capitaliste, un capitalisme originel, puisqu'il se contentait de
prélever un impôt, un tribut sur les pays que ses
armées soumettaient. En dehors de cette dime (comme les grands
groupes actuels) il laissait les peuples vivre comme bon leur semblait.
La royauté dirigeait tout et avait pouvoir de bannir,
d'accaparer,
de supprimer l'adversaire, le concurrent. La naissance, la
marginalisation des femmes et le droit d'aînesse assuraient la
transmission de ce pouvoir économique et politique dés
lors qu'il était accepté par le
bénéficiaire.
Nombre d'aristocrates respectaient le peuple. Certes ils sont les
princes locaux, mais ils sont aussi les protecteurs, les
défenseurs et les pères du peuple serviteur mais
apprécié.
Quelques
princes liés aux lignées royales ou féodales se
partageaient les revenus du travail des roturiers. Ils organisaient
leur vie privée en marge de la société civile du
peuple.
La révolution a fait basculer dans des mains privées le
pouvoir économique en inventant le droit de
propriété qui n'était plus lié au seul
droit de la naissance. On ne pouvait devenir noble on peut devenir
possédant.
La réalité actuelle du capitalisme dans les nations et
dans le monde aboutit à un retour vers le système
féodal puisque le pouvoir économique est détenu
par quelques milliers de personnes qui peuvent se passer
concrètement de l'avis des peuples et ils peuvent vivre en marge
de la société civil dans leurs châteaux modernes
Toutes les civilisations se construisent avec une activité
qui se tourne vers le bien être et la consommation des princes
(Palais - routes - jardins- fêtes, esclaves - domestiques) et
toujours, peu à peu, les princes demandent plus à leurs
sujets et l'épuisent. Le capitalisme va vers cette
échéance.
Michel Pinçon (CNRS)
"On leur apprend à être des
héritiers"
Culture de
l'excellence, argent et réseaux de connaissances : les grandes
fortunes françaises forment un tissu solide et puissant
où l'on n'entre pas facilement. (03/06/2005)
Familles Bettencourt, Rothschild,
Mulliez... Ils ont construit de
véritables empires, sont riches et puissants, connus du grand
public et des professionnels, fascinent la société. Les
grandes fortunes de France ne se sont pourtant pas faites en un jour et
s'entretiennent sur fond de relations sociales incessantes. Qui sont
les riches aujourd'hui ? D'où viennent-ils ? Comment
se caractérise leur population ? L'analyse du sociologue
Michel Pinçon qui observe depuis une vingtaine d'année
avec sa femme Monique Pinçon-Charlot les élites sociales.
Qui sont les riches aujourd'hui en
France ? Comment se définit cette catégorie sociale ?
Michel Pinçon. Il existe trois catégories de
riches. La première regroupe les héritiers comme par
exemple Ernest-Antoine Seillière. La seconde, les hommes
d'affaires tels que Jean-Marc Lech, le patron de l'institut de sondage
Ipsos, ou encore Pierre Belon à la tête de Sodexho. Enfin,
il y a ceux qui ont des qualités personnelles exceptionnelles
c'est-à-dire les sportifs, artistes ou bien les gens de la
télévision.
Qu'est-ce qui les
différencie ? Comment décririez-vous la
catégorie la plus importante, celle des héritiers ?
La culture de chacun est différente, notamment au sujet de la
transmission du patrimoine familial de génération en
génération. Cette transmission est une véritable
tradition familiale pour la première catégorie, celle des
héritiers.
Qu'en est-il des personnes qui ont
construit leur fortune eux-mêmes ?
Pour les gens issus des affaires, les nouveaux patrons, ils aident le
plus souvent leurs enfants à avancer dans la vie mais ne leur
transmettent pas forcément l'entreprise qu'ils ont pu fonder ou
développer. La tradition patrimoniale est loin d'être
prédominante et l'entreprise doit avant tout être prise en
charge par des personnes compétentes. Dans le cas de Pierre
Bellon, c'est un peu différent. Il a travaillé
très tôt dans l'entreprise paternelle et est par
conséquent sensible à l'idée de transmission. Il a
volontairement entamé une démarche de transmission
auprès de ses enfants, leur inculquant les compétences
nécessaires aux hommes d'affaires via, entre autres, des stages
avec le directeur financier de son entreprise.
Contrairement peut-être aux
deux premières catégories, la fortune des sportifs ou des
artistes n'est-elle pas éphémère ?
Oui, certainement. Ils sont capables de faire fortune très
rapidement. Une fortune matérielle entièrement
liée à leur personne et qui pose le problème de la
transmission en l'absence de position sociale. Personne ne peut
prédire si leurs enfants auront les mêmes talents.
Qu'est-ce qui peut assurer aux
familles que les héritiers seront à la hauteur ?
Vous savez, on leur apprend à être des héritiers et
à ne pas dilapider le patrimoine pour ensuite le transmettre,
à ne pas étaler leur fortune. Ils sont
responsabilisés très jeunes. Ils apprennent aussi
à se percevoir comme les représentants de la
lignée et pas en tant qu'individu. Ils sont dépositaires
d'un patrimoine, en charge de le transmettre.
Mais d'où viennent ces
familles ? Noblesse et bourgeoisie se sont-elles
mélangées avec le temps ?
Ces familles sont effectivement d'origine noble. Une noblesse en grande
partie reconvertie dans l'industrie ou la banque après la
Restauration, et d'où émane cette notion de dynastie, de
transmission du nom et du patrimoine. Mais aujourd'hui bourgeoisie et
noblesse se confondent beaucoup et ont d'ailleurs largement
fusionné. Une étude effectuée à partir du
Botin mondain, qui a été créé en 1903,
démontre cette mixité et l'augmentation des mariages
mixtes dans les familles. La moitié des familles de la grande
bourgeoisie sont mixtes. Par exemple, Ernest-Antoine Seillière
est issu du côté paternel d'une noblesse récente et
d'une noblesse d'ancien régime du coté des Wandel. Yves
Guéna qui, fait partie de la même famille, n'est pas noble.
Cette mixité
répond-elle à un besoin particulier ?
Les grandes fortunes ont une exigence de transmission. Or la noblesse
possède les pratiques les plus rodées pour assurer la
continuité, sachant que le nom de la lignée reste la
richesse la plus importante à leurs yeux. On observe aujourd'hui
une nouvelle noblesse, celle de l'argent, comme pour les Taittinger qui
s'illustrent dans le champagne et qui sont d'origine bourgeoise.
Quel est le pouvoir de ces grandes
familles, de ces grandes fortunes ?
On l'a vu, le nom est très important. L'identité
maintient une position dominante dans la société. Les
riches ont des privilèges, du temps pour se cultiver et
entretenir leur corps et leur image, s'instruire. Cela transfigure la
personnalité même et donne une impression d'exception
perçue finalement comme qualité personnelle.
Concrètement tout ceci influence la pratique de la cooptation
dans les conseils d'administration, les cercles et les clubs.
Vous insinuez que la
véritable richesse de ces grandes familles est sociale...
Tout à fait. Il y a différentes formes de richesse. La
première est matérielle. La seconde est culturelle : les
gens fréquentent opéras, vernissages, ventes aux
enchères... La troisième est sociale via les relations,
les clubs ou les réseaux. Une association comme le cercle
Interallié a connu au sein de son "grand conseil" des
personnalités aussi diverses qu'Edouard Balladur, Monsieur
François Ceyrac du CNPF (Ndlr : Conseil national du patronat
Français), le Général de Boissieu gendre du
Général de Gaulle, un membre de la famille Giscard
d'Estaing, des membres du Sénat... Le pouvoir de chacun se
nourrit de celui des autres. C'est la clé de
compréhension de l'énorme activité sociale qui
règne dans ce milieu. Très jeunes, les héritiers
prennent l'habitude de côtoyer les plus grands. Cela marque la
manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et leur
avenir. Dans l'école primaire de la rue de la Ferme à
Neuilly, il est courant que les parents viennent présenter leur
travail aux enfants. Quelle image les enfants ont-ils alors des
métiers, à part celle d'être plus tard PDG ou
directeur comme leur parents ?
Néanmoins, n'y a-t-il pas
des héritiers qui refusent de suivre le chemin qu'y leur est
tracé et qui dérogent à la règle ?
Si, bien sûr. Soit les héritiers gèrent leur
patrimoine, soit ils sont rentiers et exercent un autre métier.
Dans la famille Rothschild on trouve des savants et même une
danseuse classique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans n'importe
quel domaine, mais il importe d'y être à un haut niveau.
Et d'ailleurs, les membres d'une famille qui sont connus en dehors des
affaires renforcent le prestige du nom.
Vous évoquez
essentiellement les héritiers de grandes familles. Est-ce le
même schéma pour les fortunes récemment issues du
monde des affaires ?
Ceux qui ont réussi dans les affaires ont amassé une
fortune professionnelle, mais ni sociale ni culturelle. Ce qui leur
pose problème pour se hisser dans un milieu où
l'excellence émane de la personne. C'est pourquoi Bernard
Arnault ou François Pinault montrent une telle importance envers
la culture et y consacrent beaucoup d'investissements. C'est donner un
vernis culturel à l'argent, une certaine patine, voire des
lettres de noblesse. Pour le prestige social, nul besoin d'être
très riche.
Aujourd'hui, à combien
estimez-vous le nombre de familles tenant dans leurs mains
l'économie française ?
Environ 40.000 familles nucléaires. C'est-à-dire beaucoup
moins en termes de groupes familiaux. La famille Michelin au sens large
comptent une dizaine de familles nucléaires. Ces familles ont un
pouvoir économique important car elles exigent une
rentabilité de leur capital. On observe un
phénomène de financiarisation de la richesse, le capital
industriel devient un capital financier. En ce qui concerne les Wandel,
le château qui domine l'usine offrait un rapport direct avec leur
richesse quand la famille en était propriétaire.
Aujourd'hui, ils n'en sont plus propriétaires, mais exercent
leur pouvoir à travers la holding. Cela a des
conséquences sur le rapport à la fortune qui se fait de
plus en plus invisible, mais aussi sur la conscience que l'on peut
avoir de la réalité du capitalisme. Les grandes familles
sont toujours propriétaires des entreprises mais ne les dirigent
plus directement comme peut le faire un PDG. Elles n'en perdent pas
pour autant leur pouvoir.
|